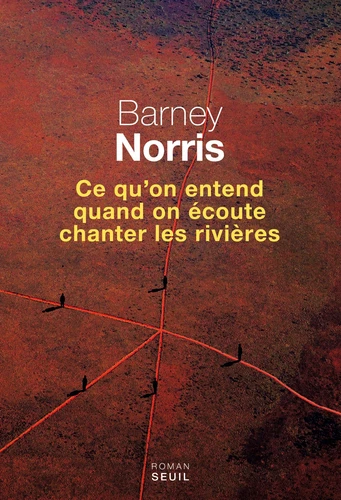 Le mot qui caractériserait le mieux Ce qu’on entend quand on écoute chanter les rivières, premier roman de Barney Norris, serait sans doute tristesse. Guère engageant si ce n’est qu’il s’agit d’une tristesse sublime, un spleen porté par une magnifique puissance d’écriture. Il y a toute la solitude de l’humaine modernité dans ces pages qui empoignent l’âme du lecteur, son mal être profond.
Le mot qui caractériserait le mieux Ce qu’on entend quand on écoute chanter les rivières, premier roman de Barney Norris, serait sans doute tristesse. Guère engageant si ce n’est qu’il s’agit d’une tristesse sublime, un spleen porté par une magnifique puissance d’écriture. Il y a toute la solitude de l’humaine modernité dans ces pages qui empoignent l’âme du lecteur, son mal être profond.
Cinq destins, comme cinq rivières qui se jettent dans l’Avon à Salisbury. Cinq personnages qui se sont croisés et qu’une scène d’accident réunit sans même qu’ils le sachent. Le cinquième explicite le lien tissé en filigrane par les quatre récits précédents. Tous d’une humanité telle qu’il ne fait aucun doute qu’on les a déjà rencontrés, croisés au détour d’une rue sans que leur vie nous préoccupe. Car c’est bien de gens ordinaires dont il s’agit ici, de ceux qui mènent une vie banale et voudraient juste comprendre ce qu’ils vivent et pourquoi.
Rita, la première narratrice, saisit par sa hargne, son franc-parler et sa solitude. Elle croyait en la vie, elle aimait Jonno mais elle a fait les mauvais choix. Seule avec son fils né trop tôt, elle a erré, l’a laissé pousser au gré du vent, a trop bu. A la soixantaine elle n’a plus personne et plus rien : son fils ne veut plus la voir et lui interdit sa femme et sa fille, Jonno ne la connaît plus, elle a à peine un toit et vend des fleurs sur un stand au marché. Elle vend de l’herbe aussi et va se faire coincer. Rita crie sa vie de merde et c’est sa solitude qu’on entend, ainsi que ses rêves fracassés et sa vitalité disparue.
Mais dès que je m’arrête et que je pense à ce qui m’est arrivé, je vois ma vraie vie, celle qui aurait dû être la mienne, juste sous la surface des choses, hors d’atteinte. C’est comme s’il y avait un autre moi sous ma peau, que j’ai enterré là et qui ne sortira jamais. Un autre moi qui aurait pu avoir une vie d’enfer et qui est condamné à me regarder galérer. Chaque jour, je suis hantée par mes ratages, famille fantôme, maison fantôme, argent fantôme, bonheur fantôme. Une vraie malédiction gitane. Etre capable de voir tout ce qui aurait pu être si seulement on n’avait pas merdé.
Rita cède la place à Sam, quinze ans, un ado solitaire qui peine à communiquer. Il vit en marge des adolescents de son âge, ne partageant aucun de leurs intérêts. Quand tout à coup, c’est le coup de foudre pour Sophie. Il ne se fait aucune illusion, lui l’insignifiant, mais il est obnubilé. Ce choc advient simultanément à un autre : son père est atteint d’un cancer déjà très avancé. Sam ne connaît ni l’amour ni la mort, juste son père qu’il admire et qui part, le laissant désemparé.
George, le troisième narrateur ne l’est pas moins puisque ce vieil homme vient de perdre sa femme Valerie. Alors qu’il quitte l’hôpital où elle vient de mourir, il renverse une femme à mobylette : c’est Rita. Sam et Alison, la quatrième narratrice, assistent à l’accident.
Tous anonymes, simples gens ordinaires, se sont croisés dans les rues de Salisbury. Chacun est un drame, un petit drame individuel qui illustre celui bien plus vaste de la condition humaine : pourquoi n’aime-t-on pas la bonne personne ? Pourquoi celui ou celle qu’on aime nous est-il enlevé ? A quoi sert-on ? Y aura-t-il quelqu’un pour nous regretter ? Serait-on passé à côté de la vie ?
On passe sa vie à ressasser la même chanson et tous ces projets demeurent à l’état de plans qu’on échafaude en buvant son thé dans la même cuisine, à la même lumière de la même interminable matinée. Ou, en ce qui me concerne, chaque année dans une cuisine différente qui ressemble comme deux gouttes d’eau à la précédente, environnée du même silence, tandis que j’attends.
On est à des années-lumière du feel good book à la mode. Aucun de ces personnages ne vaincra la mort, la maladie et la solitude. Il n’y a pourtant aucune complaisance dans le malheur ni aucun pathos. L’émotion étreint le lecteur à chaque récit car chaque narrateur est une part de l’éternelle humanité, une part de nous-mêmes. Même si on n’est pas un adolescent de quinze ans ou une femme au foyer suicidaire, les mots nous touchent car ils nous concernent. Ils sont énoncés avec une simplicité qui permet l’identification et intensifie le réalisme des propos. Car Barney Norris donne voix et donc vie à des personnages extrêmement différents avec une même virtuosité. Tous sont brutalisés par la vie, souffrants mais non plaintifs, ils s’interrogent sur la vie, leur vie, avec des mots simples.
Parfois pourtant, cette simplicité se fait lyrique et dépasse la tristesse profonde qui les habite tous.
… je traverse les rideaux de bruine sous les arbres qui ont retenu la rosée entre leurs bras aimants toute la nuit et la reposent délicatement à l’arrivée du matin. Je me souviens des soirées où nous prenions des psilos dans le parc, je me souviens de la brûlure de la vodka dans ma gorge, de baisers si beaux que je n’aurais même pas rêvé de les voler derrière ces haies, de chansons jouées sur des guitares désaccordées qui semblaient électriques lorsqu’elles brisaient la paix de ce lieu. J’entends le chant des oiseaux dont les trilles s’entrelacent dans l’air. Et alors je me dis : pas encore. Je ne partirai pas tout de suite. Quand je marche, je sens qu’il y a une grâce à tenter de recueillir au creux de ses mains la vie qui coule, à essayer de la retenir un instant avant qu’elle ne disparaisse, chassée par une eau nouvelle. Le monde s’achève sans cesse autour de nous. Chaque mesure de notre partition appartient déjà au souvenir et à l’imagination au moment où nous la jouons. Autant l’écouter.
Ce qu’on entend quand on écoute chanter les rivières est un roman qui nous donne à voir les autres, qui nous offre un regard sur tous ces gens que l’on croise sans les voir et qu’on oublie. Ils n’ont pas de vie, ils sont les autres, ni amis ni famille ni collègues, mais pourtant chacun d’entre eux est un peu nous. Parce qu’ils ont vécu et parce qu’ils sont blessés.
Pourtant, tous ces hommes et ces femmes avaient éprouvé des sentiments aussi réels que les miens, ils avaient vécu avec une intensité douloureuse qui les surprenait eux-mêmes. La vie est trop complexe et extraordinaire pour pouvoir espérer véritablement comprendre les autres. C’est à peine si on prend le temps de s’observer soi-même. Comment plonger le regard au cœur d’un être quand on se débat dans sa propre confusion intérieure ?
A cette dernière question Barney Norris apporte une évidente réponse : en lisant.
.
Ce qu’on entend quand on écoute chanter les rivières
Barney Norris traduit de l’anglais par Karine Lalechère
Seuil, 2017
ISBN : 978-2-02-134014-3 – 300 pages – 20 €
Five Rivers Met on a Wooded Plain, parution en Grande-Bretagne : 2016
Bon, après un billet pareil, il ne me reste plus qu’à noter. Je sens que je vais encore solliciter la bibliothèque.
Bon, si c’est un coup de coeur… Plombant quand même, non? (je te parie qu’en plus il pleut durant tout le bouquin) Mais à voir (comme Aifelle)
Non, pas plombant, mais ça serre les tripes, c’est certain. Et pas une goutte de pluie, mauvaise langue 😉
Je note aussi, puisque c’est un coup de coeur, et une note très engagée …. Mais comme Keisha, je crains le plombant …. (et la pluie …)
L’auteur évite beaucoup de clichés, dont le ciel las et lourd…
Très beau billet, mais voilà je suis en ce moment dans un moment de tristesse et ce matin je me réveille avec les nouvelles de Barcelone alors aurais-je la force de lire un livre qui raconte les difficultés de la vie ordinaire?
Tu es convaincante, et quel beau titre ! Je prends note (soupir)…
Coup de coeur…? Arghhhh…. je suis faible…
Je cède devant un tel billet. Tout me parle dans ce que tu en dis. Direction la librairie dès demain matin !
Comme les autres, j’aurais dit « pfiou, plombant quand même » mais ton enthousiasme intrigue. Je vais y regarder de plus près.
Je ne peux que prendre note aussi 😉
Enfin un roman qui n’a pas une happy end !
J’ai envie de le lire mais vue la tristesse dont il semble imprégné : pas tout de suite.
Je sens que c’est un livre qui connectent les gens vers les autres, j’adore ce genre de livre, ils sont rares mais ils réveillent l’empathie et le regard sur le monde, permet de ne plus juger les gens mais essayer de les comprendre ! Je vais directement le noter dans ma wish list parce que j’ai une folle envie de le lire !
Oh, I need this! anyway, je résiste rarement à tes petits coeurs qui sautent!