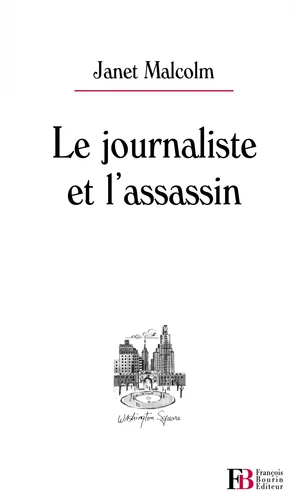 Ce livre est constitué à l’origine de deux longs articles de Janet Malcolm parus dans le New Yorker en 1989. Le métier de journaliste, et plus particulièrement la trahison journalistique en est le thème. De même que la relation entre auteur et sujet et le choix entre principes ou absence de scrupules au nom de la vérité. Janet Malcolm elle-même journaliste y développe le procès MacDonald contre McGinnis dans lequel le plaignant était un homme condamné pour triple meurtre.
Ce livre est constitué à l’origine de deux longs articles de Janet Malcolm parus dans le New Yorker en 1989. Le métier de journaliste, et plus particulièrement la trahison journalistique en est le thème. De même que la relation entre auteur et sujet et le choix entre principes ou absence de scrupules au nom de la vérité. Janet Malcolm elle-même journaliste y développe le procès MacDonald contre McGinnis dans lequel le plaignant était un homme condamné pour triple meurtre.
En février 1970, Colette MacDonald, enceinte, et ses deux jeunes enfants sont retrouvées assassinées (rouées de coups et poignardées). Jeffrey MacDonald, médecin militaire, est d’abord accusé puis innocenté suite à un procès par un tribunal militaire. Mais l’enquête reprend en 1971 et en 1979, MacDonald comparait devant un tribunal civil pour triple meurtre alors qu’il est un médecin réputé, chef du service des urgences à l’hôpital St. Mary de Long Beach (Californie).
En juin 1979, MacDonald rencontre Joe McGinnis, un journaliste qui a déjà fait ses preuves mais pour l’heure en mal de reconnaissance. Le médecin lui demande s’il veut suivre son procès et écrire ensuite un livre ; pour ça, il lui offre de rejoindre l’équipe de ses défenseurs « en ayant accès à tout : stratégie, tactiques et discussions ».
A l’issue du procès, MacDonald est reconnu coupable et emprisonné à vie. McGinnis correspond avec lui, le rencontre en prison, le tenant au courant de l’avancée de son travail, l’assurant de son amitié. L’enquête de McGinnis dure quatre ans. Or, quand le livre de six cents pages, Fatal Vision, est publié, il tend à prouver la culpabilité de MacDonald car le journaliste a acquis la conviction que le médecin est bien l’assassin.
C’est alors, en 1984, que MacDonald intente un procès en diffamation à McGinnis qui l’a trompé pendant toutes ces années, qui a trahi sa confiance. Les questions soulevées pendant le procès MacDonald-McGinnis sont donc d’ordre éthique : jusqu’où un journaliste peut-il aller pour divulguer ce qu’il estime être la vérité ? Peut-on tromper le sujet d’une interview pour récolter le maximum d’informations et arriver à ses fins ? Et peut-on ouvertement revendiquer le mensonge et la trahison comme moyen d’investigation sans encourir la mise au ban d’une profession, voire de la société ?
Faute d’unanimité dans le procès MacDonald-McGinnis, le jury n’a pas pu se prononcer. Alors que l’éventualité d’un deuxième procès (pour tromperie et violation de contrat) se fait jour, l’avocat de McGinnis cherche un journaliste susceptible d’expliciter clairement le danger que selon lui, une condamnation de son client impliquerait : « un nouveau précédent qui ferait obligation légale à tout auteur d’informer le sujet de son livre de son état d’esprit envers lui durant la phase d’écriture et de recherche ». Janet Malcolm accepte et rencontre divers protagonistes des deux procès (celui de MacDonald pour assassinat et celui de McGinnis pour diffamation), autant de défenseurs que d’accusateurs de MacDonald : ce livre est le résultat de ses rencontres.
Ce texte de Janet Malcolm est précieux à bien des égards. Traditionnellement, il rend compte de la casuistique juridique, assez pointue car les interrogatoires s’avèrent dès lors subtils, quasi jésuitiques : « Un mensonge est une chose qui n’est pas vraie, dite par malveillance ou de mauvaise foi, alors qu’un semi-mensonge fait partie d’une construction qui peut conduire à la vérité ».
Il tente de rendre compte objectivement dans un premier temps de la personnalité de MacDonald, de son inhabituel statut de coupable et de victime : les jurés « voyaient en lui un être presque – sinon totalement – racheté, qui avait souffert, qu’il ne leur appartenait pas de juger, et qui avait été puni par McGinnis de manière aussi excessive qu’injuste ». Il cerne aussi McGinnis, le journaliste sans scrupules, le traître froid et calculateur qui trahit la confiance de MacDonald afin qu’il continue à coopérer et qu’il puisse publier son best-seller. Il s’avère rapidement que Janet Malcolm se retrouve à la même place qu’occupait McGuinnis défendant MacDonald. Car rapidement, McGinnis est antipathique à Janet Malcolm. Ce qu’on apprend dans la postface de l’auteur, c’est qu’elle avait été quelques temps avant elle-même accusée de diffamation pour un ouvrage précédent.
Au-delà des procédés, ce qui est en jeu, c’est le travail de l’écrivain, de ces écrivains-journalistes qui, à l’image de Norman Mailer et Truman Capote enquêtent minutieusement, se lient avec les principaux protagonistes des faits divers qu’ils reprennent au point de s’investir personnellement et émotionnellement. « Roman policier-réalité », « roman-réalité », « non fiction »… le spectre terminologique est large pour désigner des œuvres littéraires qui prennent la réalité pour socle, prônent l’objectivité mais utilisent les outils du romanesque.
Dès lors quelle relation le journaliste entretient-il avec son sujet, qui n’est pas ni une idée ni une fiction mais un être humain vivant ?
Le journaliste qui n’est ni trop bête ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face le sait bien : ce qu’il fait est moralement indéfendable. Il est tel l’escroc qui ne nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude ; il gagne leur confiance et les trahit sans remords.
Il est aussi question du statut des journalistes, qui place le lecteur dans une position de confiance dépendante : « le ‘Je’ journalistique est un narrateur auquel on peut faire une confiance aveugle ; c’est un fonctionnaire auquel on a confié les tâches cruciales de la narration, de l’argumentation et du ton, une entité ad hoc semblable au chœur dans la tragédie grecque. Il s’agit d’une figure emblématique, une personnification de l’idée de l’observateur dépassionné de la vie ».
L’ancienneté de ces textes de Janet Malcolm n’enlève rien aux problèmes éthiques qu’ils soulèvent. Les méthodes journalistiques sont exposées et finement analysées sans détours, permettant à chacun de s’interroger sur la pertinence du concept de déontologie journalistique. C’est évidemment polémique et stimulant.
Le journaliste et l’assassin
Janet Malcolm traduite de l’anglais par Lazare Bitoun
François Bourin, 2013
ISBN : 978-2-84941-371-5 – 217 pages – 20 €
The Journalist and the Murderer, parution aux Etats-Unis : 1990
Voilà un livre que je n’aurais pas l’idée de lire mais ton billet est brillant et très intéressant, bravo à toi, toutes tes réflexions sont passionnantes !
C’est ce livre qui l’est, très stimulant. J’espère que beaucoup de gens le liront.
Un livre qui m’intéresse. Noté.
Bonne lecture.
ton billet est passionnant et donne très envie de se plonger dans ce livre
merci
Luocine
Ah merci, tant mieux ! C’est un livre qu’on a envie de faire lire parce qu’on a envie d’échanger sur le sujet après lecture, c’est très stimulant.
super billet ! Je note !
J’espère que tu pourras le lire !
Ton blog a bien changé mais c’est sympa comme cela aussi. Ce livre me tenterait bien et j’aime bien ce genre de récit aussi.
Contente que tu apprécies le nouveau design 😉
Je « découvre » ton billet! (oui, le 23 juillet j’étais sûrement mal éveillée).
Je l’ai trouvé à la bibli en août, complètement par hasard, et l’ai englouti avec fascination! Fichtrement intéressant, franchement!
Disons que la torpeur estivale n’est pas le meilleur moment pour qu’un billet soit beaucoup lu…