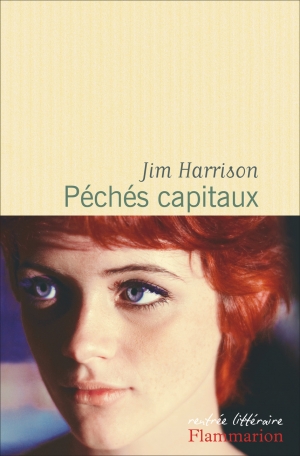 Où l’on retrouve Simon Sunderson, ex-flic, ex-époux de Diane, déjà protagoniste de Grand maître. Mona, sa fille adoptive devenue étudiante, vient de plaquer la fac pour suivre son petit ami du moment à New York puis Paris. Le gars est batteur dans un groupe et il ne plait pas du tout à Diane qui appelle son ex pour qu’il aille la récupérer. Et voilà Sunderson extorquant l’argent d’un chantage puis battant le pavé du quartier latin à la recherche de sa « fille ». Qui ne tarde pas à devenir sa maîtresse. Oh il s’en veut bien sûr ce sexagénaire, mais que voulez-vous, c’est elle qui a commencé et la chair est faible !
Où l’on retrouve Simon Sunderson, ex-flic, ex-époux de Diane, déjà protagoniste de Grand maître. Mona, sa fille adoptive devenue étudiante, vient de plaquer la fac pour suivre son petit ami du moment à New York puis Paris. Le gars est batteur dans un groupe et il ne plait pas du tout à Diane qui appelle son ex pour qu’il aille la récupérer. Et voilà Sunderson extorquant l’argent d’un chantage puis battant le pavé du quartier latin à la recherche de sa « fille ». Qui ne tarde pas à devenir sa maîtresse. Oh il s’en veut bien sûr ce sexagénaire, mais que voulez-vous, c’est elle qui a commencé et la chair est faible !
D’ailleurs, toutes les femmes croisées dans Péchés capitaux y passeront, qu’elles aient dix-neuf ans ou quarante. Est-ce l’ex-inspecteur en lui, de surcroît chargé de traquer un pédophile dans une précédente enquête, qui l’empêche de concrétiser avec la jeune Kate de quatorze ans ? Toujours est-il qu’il ne franchit pas la ligne, trop plongé peut-être dans une réflexion sur le Mal.
Imprégné depuis l’enfance de morale luthérienne, Sunderson s’interroge plus que jamais sur ce qui dresse les hommes entre eux. Il connaît la liste des sept péchés capitaux, reconnaît sans mal avoir cédé à tous, et à certains plus qu’à d’autres, pour finir par conclure qu’il en est un à l’origine de tous : la violence. Elle était là, dès l’aube de l’humanité comme le symbolisent Caïn et Abel. Dans sa carrière de flic, il l’a côtoyée plus que n’importe qui et n’aspire plus désormais qu’à la tranquillité.
C’est pourquoi il s’offre une cabane, un coin de pêche solitaire où pratiquer sa passion loin de l’agitation du monde. Et c’est là que la violence le retrouve, incarnée par la famille Ames.
Selon tous les critère en vigueur, les Ames étaient une bande de dingues certifiés, un incident génétique consternant.
Les mâles de la famille violent les filles dès qu’elles ont neuf ans, les frappent, boivent comme des trous. Personne ne veut d’histoire avec eux, surtout pas la police qui se tient à l’écart de ces violents qui n’obéissent à personne. Grâce à leurs vaches, ils ne manquent pas d’argent mais vivent en autarcie dans la crasse et l’ignorance. La violence est leur seule credo. Sunderson va-t-il faire comme s’il ne les voyait pas ? Ça ne va pas être facile vu qu’une des filles Ames vient lui agiter son derrière sous le nez et que sa soeur se fait tuer par un cousin. Ce qui n’est le début de l’hécatombe : les uns après les autres, les Ames tombent comme des mouches, empoisonnés.
Sunderson est bien obligé de s’intéresser à cette famille. D’une part il sent son vieux coeur palpiter pour la chaude Monica, d’autre part, Lemuel, le moins dégénéré de la famille, lui fait lire les chapitres de son roman policier. Qui reprend fidèlement l’histoire de sa famille. Sunderson se trouvant lui-même des velléités d’écriture accepte de seconder l’inspecteur Smolens dans son enquête. Même s’il est quand même largement partie prenante en raison de sa liaison avec Monica Ames, qu’il finit par arracher à sa famille pour l’installer à Marquette, près de lui.
Si Sunderson s’intéresse de si près à cette famille de dégénérés monstrueux et violents, c’est qu’elle incarne ses interrogations sur la violence.
La violence est une tradition ancestrale en Amérique, dit Lemuel. A l’école, les livres d’histoire ne parlent pas des milliers de lynchages ni de cette habitude de tirer vers le sol dans les tipis pour tuer les femmes et les enfants indiens pendant leur sommeil. Beaucoup de journaux ont proclamé qu’il fallait exterminer tous les Indiens, comme la presse nazie dans les années trente avec les Juifs.
Pour Sunderson c’est clair : la violence est le huitième péché capital.
Jamais Sunderson n’arrêtera de boire, jamais Sunderson n’arrêtera de détrousser tout jupon qui voudra bien de lui. Il est fait comme ça. Mais il ne fait ainsi de mal qu’à lui même. Il est devenu flic pour empêcher que la violence brise les plus faibles, pour que des malades comme les Ames ne règnent pas en maîtres sur leurs femmes et leurs enfants. Et de se remémorer les nombreux cas semblables ayant jalonné sa carrière de flic.
Maître-chanteur à New-York et amant de sa propre fille, Sunderson vaut-il mieux qu’eux ?
Dans Péchés capitaux, le vieux Jim Harrison joue sur deux registres : la gauloiserie un peu lourde et la réflexion existentielle ; la légèreté de l’un ne dissipant pas la gravité de l’autre. On s’amuserait volontiers aux descriptions égrillardes du vieux libidineux, sauf qu’elles sont vraiment nombreuses et finissent par lasser (la lectrice que je suis, le lecteur s’en réjouira peut-être…). On est certes loin d’une littérature politiquement correctement qui chanterait les louanges de l’éternel féminin : il faut une femme, de préférence jeune, à Sunderson pour la baise et la bouffe. Et une ou deux autres « car tout le plaisir de l’amour est dans le changement« , comme dirait l’autre.
La répétition de ces scènes qui semblent réjouir Harrison, c’est comme le libidineux de service qui s’obstinerait à parler cul à table : on lui pardonne parce qu’il est vieux, bien gentil dans le fond, mais un peu lourd quand même…
Péchés capitaux
Jim Harrison traduit de l’anglais par Brice Matthieussent
Flammarion, 2015
ISBN : 978-2-08-131-3095 – 350 pages – 21 €
The Big Seven, parution aux États-Unis : 2015
Un peu lourd effectivement. J’apprécie l’auteur mais je ne suis pas vraiment tentée par ce thème. Ma PAL te dit merci.
Il me semble que plus le temps passe et plus cette tendance d’Harrison de rabâcher sur le sexe s’affirme…
Harrison vieillit… Dalva c’était mieux (oui, je vais te faire réagir, je l’ai fait exprès ^_^) je préfère quand il y a plus de nature et moins de ‘libidinage’
Je resterai stoïque à l’évocation de Dalva car moi aussi je vieillis et deviens raisonnable (on n’évolue pas tous de la même façon…). Ceci dit, il y a de la nature dans Péchés capitaux, de belles parties de pêche, avec cadavre en bordure de rivière !
Son côté libidineux m’avait déjà déplu avec son dernier, je suis donc hésitante !
Tu le retrouves ici dans le même état 🙂
je ne suis pas certaine de plonger là car ses derniers livres m’avaient fortement déçu on verra
Je suis loin d’avoir lu tous ses livres, mais il me semble que ses romans les plus récents non plus la force des anciens…
Je suis en traîn de le lire, ça part un peu dans tous les sens au départ mais pour l’instant je ne suis pas lassée même si effectivement le côté sexe le tourmente pas mal 🙂 mais je n’en suis qu’à la moitié…
J’ai relu plusieurs fois le passage mais je n’ai pas réussi à vraiment comprendre pourquoi tout à coup cet ex-flic honnête fait chanter quelqu’un…
je me pose la même question d’autant que ça n’a pas grand chose à voir avec le reste, sauf à constituer un élément de cette méditation tout azimuth – et singulièrement dénuée de jugement, sur la retraite, le désœuvrement, la vieillesse, l’impuissance, une part de revanche sur toute la violence vue au cours du temps peut-être…
J’adore ta comparaison finale 😉
Je me suis dit que c’était une bonne façon de condenser cet aspect-là des choses, pour ceux qui n’auraient pas la patience de lire le billet en entier 😉
Il m’attend et je m’en réjouis, même pas peur des lourdeurs du vieux libidineux 😉
Je lirai avec curiosité un avis masculin sur ce roman…
J’avoue être assez curieuse !
J’ai trouvé ça limite glauque parfois, mais bon, ce n’est que mon avis…
heureusement que c’est glauque!
Comme beaucoup de lecteurs j’ai bien aimé Jim Harrison , mais j’ai déjà renâclé à son dernier roman dont j’ai oublié le titre, pas sûr que je lise cette histoire de vieux qui couche avec sa fille. Cependant je suis certaine que l’Amérique a un penchant pour la violence qui doit a sa place en littérature.
Oui, et cet aspect-là particulièrement intéressant, m’a poussée à poursuivre ma lecture. Le vieux croulant, alcoolique de surcroit, qui saute sur tout ce qui porte jupon m’intéressant moins…
Je ne suis pas tentée, alors que j’ai beaucoup aimé certains romans du grand Jim… avant.
Je n’ai jamais été vraiment fan, le grand Jim a su m’ennuyer (trop de nature, tu sais), mais il est clair qu’il ne fait à mes yeux pas partie des écrivains qui se bonifient avec l’âge…
Haha tu lis tous les romans de ma Wish List Rentrée littéraire x)
Nous avons les mêmes bons goûts 😀
Pareil que mes camarades Keisha et Dominique : j’ai adoré le Jim Harrison de Dalva et autres romans de la même époque mais j’ai vraiment calé sur les derniers… Donc je passerai sans doute mon tour pour celui-là !
C’est dommage quand même de tomber en désamour d’un auteur…
Oui c’est triste 😦
Pas lu, ni Grand maître, ni Dalva, mais celui-là me plait bien. Je vieillis en même temps que Big Jim alors mon côté libidineux doit autant ressortir… et plus c’est lourd, plus j’apprécie… surtout si en plus on peut pêcher en même temps…
J’espère pour lui qu’il ne s’adresse pas uniquement aux lecteurs qui lui ressemblent…
Je suis en train de le lire. Grand fan de l’écrivain autrefois, il est vrai qu’aujourd’hui je le lis plus, en raison de cette vieille amitié littéraire, que pour le strict intérêt de ses romans… Moi aussi, je suis agacé par ses scènes de sexe entre vieux libidineux et jeunettes délurées, même s’il faut y voir une part d’humour.
Je l’ai apperçu dans La Grande Librairie hier et ça ne m’a pas tenté…
Oh mince alors je viens juste de dire chez Galéa que je le lirai bien mais là je suis un peu refroidie!
Retourne lui dire que tu as peut-être trouvé un billet pour te faire changer d’avis 🙂
Je reviendrais lire ton billet en détail, car je veux absolument le lire celui-là, et je vois que c’est bien à livre A LIRE pour toi, et ça me fait bien plaisir 🙂
Tous les livres de Harrison sont à lire à mon avis (même si je ne les ai moi-même pas tous lus…) : ses défauts, de plus en plus prégnants avec le temps me semble-t-il, ne sont pas (encore !) une contre-indication 😉
Bof je passe. Harrison, tout comme John Irving prennent de l’âge et vu leur succès respectif n’ont plus à se préoccuper de ce que pense leur lectorat. Alors ils écrivent ce que bon leur semble point à la ligne 😉
Personnellement, je préfère de très très loin John Irving !
J’aime bien Jim Harrison, c’est même l’un des écrivains américains que j’ai lu le plus, mais les scènes de cul et de boisson, ça va un moment. Ado, j’ai lu Bukowski, et puis il m’a lassé très vite
Il faut pouvoir les apprécier pour autre chose que les histoires qu’ils nous racontent. J’avoue ne pas toujours y parvenir non plus…